 |
Nous recherchons Jésus...
Mythe ou réalité!
 |
Nous recherchons Jésus...
Mythe ou réalité!
3.3.2 Les sources juives
a)
FLAVIUS Josèphe 37-100 Les antiquités juives (93-94).
Dans ce dernier ouvrage, deux passages nous intéressent: Ananus
rassemble le sanhédrin des juges et fit comparaître devant
eux Jacques le frère de Jésus, dit le Christ, ainsi que
quelques autres; il les accusa d’avoir violé la loi et les
livra à la lapidation.
(Antiquités juives, XX, 200);

En ce temps-là paraît Jésus, homme sage, si toutefois il faut l’appeler homme; car il était l’auteur d’oeuvres prodigieuses, le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Et comme, sur la dénonciation des premiers parmi nous, Pilate l’avait condamné à la croix, ceux qui l’avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. (Car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau; les prophètes divins avaient dit ces choses et dix mille autres merveilles à son sujet.) Jusqu’à maintenant encore, le groupe des chrétiens, ainsi nommé à cause de lui, n’a pas disparu. (Antiquités juives, XVIII, rapporté par Eusèbe, Histoire ecclésiatiques, I, 11).
Ce passage pose problème, car il
a des résonances pratiquement chrétiennes. Or, Origène
qui avait lu Flavius Josèphe déclare de lui: " Tout
en refusant de croire en Jésus comme Christ (...), il n’était
pas loin de la vérité " (Contra Celsum, I, 47).
Par contre, Eusèbe en fait pratiquement un témoin juif en
faveur de la messianité de Jésus. D’où l’idée
qu’il s’agit peut-être d’une interpolation chrétienne
insérée entre le temps d’Origène et 325. Dès
le XVIe siècle, on mettait en doute l’authenticité
de ce passage et, dans son editor maior des Antiquités
juives en 1890, Niese mettait ce passage entre crochets. Depuis lors,
la discussion a connu de nombreux rebondissements et hypothèses.
Si certains critiques continuent de rejeter le passage comme inauthentique,
plusieurs autres, pensent plutôt que le passage a été
glosé*, hypothèse défendue pour la première
fois simultanément en 1941 par Richards en Angleterre et Martin
en Belgique.
Tout d’abord, personne ne conteste que le vocabulaire et le
style soient ceux de Fl. Josèphe et il est remarquable que le passage soit
attesté dans tous les manuscrits. Par ailleurs, il est tout à fait
vraisemblable que Josèphe, écrivant dans les années 90 et
connaissant bien des mouvements juifs aussi divers que les pharisiens, les sadducéens,
les esséniens et les zélotes, connaisse aussi les chrétiens.
Par souci de sa réputation historique, il était normal qu’il
en parle. Pour lui qui était pharisien, la dissidence essénienne
était au moins aussi étrangère que la chrétienne.
D’où l’hypothèse de l’authenticité globale
du morceau sur les chrétiens, à l’exception des passages notés
en caractères gras. On peut supposer que ceux-ci avaient d’abord été
ajoutés en marge par un copiste chrétien, à titre de complément,
de commentaire. Un autre copiste a pu croire à un passage omis et l’insérer
dans le texte. Il faut savoir que c’est dans le monde chrétien que
les oeuvres de Josèphe ont été transmises. Par contre, il
n’y a aucune raison de faire la même supposition pour le passage entre
crochets. En effet, il peut très bien avoir été écrit
par Josèphe comme rapportant le point de vue des disciples de Jésus
(ce que devait faire un historien) et le vocabulaire n’est pas celui qui
est devenu classique chez les chrétiens. Par exemple, le mot grec utilisé
par Josèphe pour les apparitions est ephanè et non le mot
chrétien habituel ôphthè.
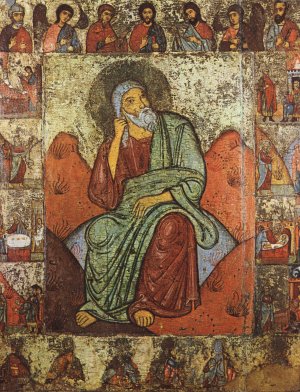
b) Le Talmud de Babylone (VIe s)
Il ajoute à la Mishnah des traditions non reprises dans celle-ci par les docteurs tannaïm (enseignants). Dans le traité Sanhédrin, on lit::
La tradition rapporte: la veille de la Pâque, on a pendu Jésus. Un héraut marcha devant lui durant quarante jours disant: il sera lapidé parce qu’il a pratiqué la magie et trompé et égaré Israël. Que ceux qui connaissent le moyen de le défendre viennent et témoignent en sa faveur. Mais on ne trouva personne qui témoignât en sa faveur et donc on le pendit la veille de la Pâque. (Sanhédrin, 43a)
Ce texte apparaît comme une justification de la mise à mort de Jésus qui n’est pas contestée, mais validée. Par ailleurs, il suggère que ce dernier aurait normalement dû subir le supplice de lapidation réservé aux condamnés pour motif religieux, et non celui de crucifixion (pendaison à la croix) réservé aux droits communs et aux esclaves. Enfin, il confirme la chronologie adoptée par Jean qui fixe la mort de Jésus à la veille et non le soir de la Pâque, comme le suggèrent les synoptiques qui font du dernier repas de Jésus un repas pascal.